Carnet de lecture pour Ravage – Barjavel
Un mot : Apocalyptique.
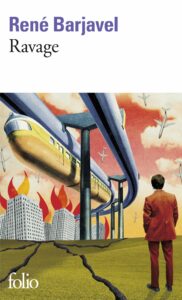
Après La Nuit des Temps, je me suis laissé embarquer dans « Ravage » de René Barjavel. Bien que publié en 1943, ce texte est terriblement moderne, tant dans sa forme que sur le fond : une écriture dynamique, toujours aussi graphique et appelant, tout comme La nuit des temps, à une représentation visuelle… on imagine tellement une adaptation en film ou en série ! The Walking Dead et The Last of Us ont trouvé leur vénérable ancêtre !

Ravage c’est donc un roman d’anticipation dystopique qui commence comme vision idéalisée de ce qu’aurait pu être le futur, tel que fantasmé dans les années 1940, et qui va rapidement sombrer dans l’apocalypse post-technologique.
On démarre en 2052 dans un monde ultra-technologique. Paris est une mégalopole futuriste : tout est électrique ou alimenté à la « quintessence ». Pour autant, les inégalités capitalistes sont exacerbées, avec la vision classique de la « ville du haut » en opposition aux bas-fonds.
Ce monde parfait bascule soudainement lorsque toutes les sources d’énergie s’éteignent simultanément, sans explication, à l’encontre des lois fondamentales de la physique. La société s’effondre rapidement : les villes deviennent des pièges mortels, entre les méga feux, les pillages, la maladie et la famine.
François Deschamps – Le héros du roman – parvient à s’échapper de Paris avec un groupe de survivants. On suit alors leur lutte pour la survie, leurs confrontations face à d’autres groupes, face la barbarie, et parfois même face à un irrationnel déroutant et non expliqué…
Spoilers :
Les quelques survivants s’installent finalement dans le Sud de la France, loin de Paris, symbole du retour à la vie simple, de l’harmonie avec la nature, et prônant le retour à la terre et le rejet de la technologie.
Cette célébration de la vie rurale et des compétences manuelles prend alors une tournure anti-technologique et se termine comme une critique de cette dépendance, qui a rendu les humains faibles et vulnérables : La disparition de l’électricité étant la démonstration évidente de leur incapacité à survivre sans elle.
Outre la méfiance envers le progrès scientifique et technologique, soulignant les risques d’une course effrénée vers un futur déshumanisé, le roman diffuse aussi une certaine apologie du retour au Patriarcat et au Culte du Chef. Rappelons que le roman a été écrit durant l’occupation de la France par l’Allemagne : on peut voir une allusion au Pétainisme et à l’idéologie du régime de Vichy dans la glorification des valeurs traditionnelles : importance de la famille, de la solidarité et du respect de la nature.
Néanmoins, ce caractère politique ne gâche pas le roman car il n’est pas manichéen et n’idéalise pas le gouvernement pour autant : la critique de cette société idéalisée est largement influencée par 1984 de Orwell : références aux ministères absurdes (ministères du Progrès social, de la Moralité publique, de la Production et de la Coordination, de la Médecine gratuite et obligatoire), « artistes diplômés par le gouvernement » seuls autorisés à peindre, ou encore les « aïeux » surgelés veillant sur leurs descendants au milieu même des habitations 😱 !
Bref, j’ai aimé : 7/10

